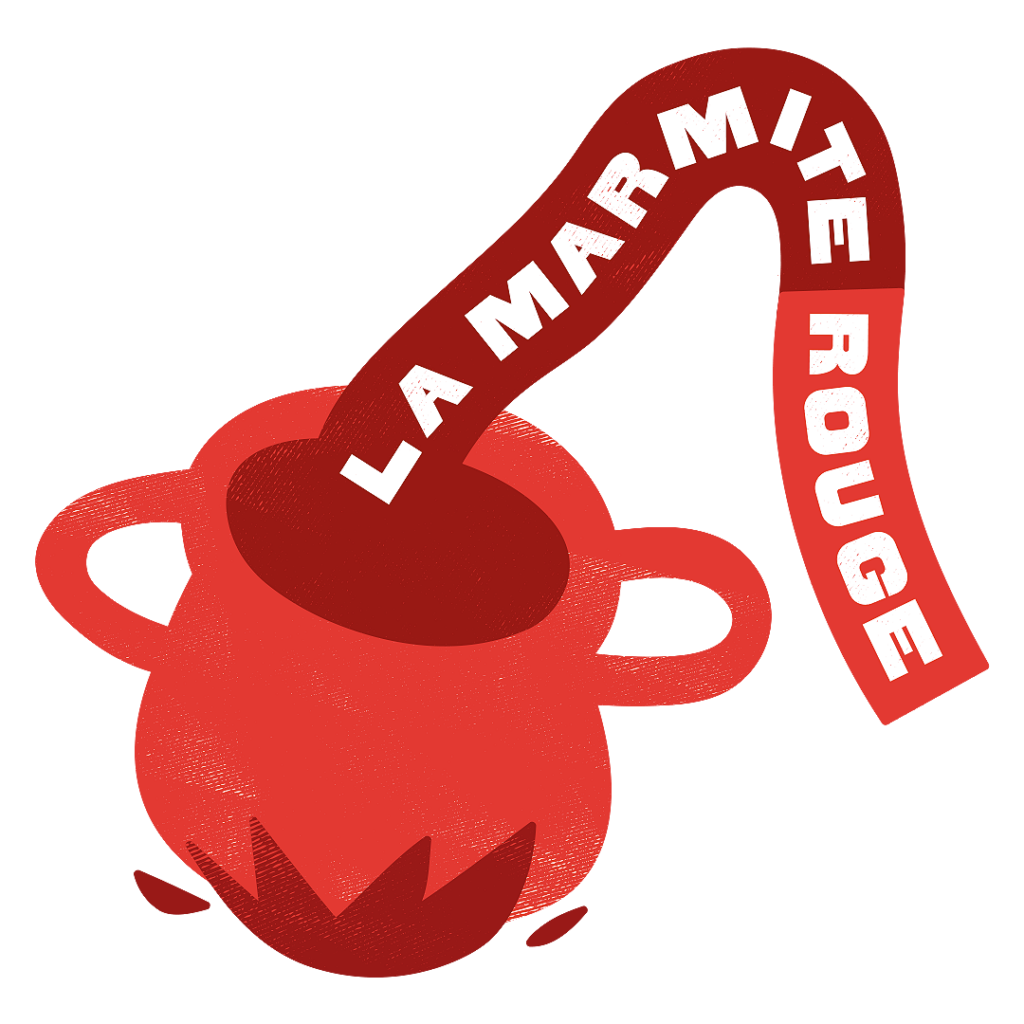En accord avec sa mission d’éducation populaire, la Marmite rouge propose des formations auprès de collectifs et organismes autour de la Sécurité sociale de l’alimentation (SSA). Durant l’hiver 2024, l’association a ainsi conçu et animé un parcours de formation en collaboration avec l’association Cop1 Solidarité Étudiante. Cette page présente le contenu de la formation et la manière dont Cop1 et la Marmite ont coconstruit le parcours de formation.
• Genèse du projet
En juin 2024, l’association Cop1 Solidarité étudiante prend contact avec la Marmite rouge. Le projet de Cop1 est de constituer une caisse de solidarité alimentaire auprès d’une centaine d’étudiant·e·s de Paris. L’esprit du projet: proposer aux étudiant·e·s de choisir des commerces à conventionner où ils et elles pourraient ensuite dépenser 100€ par mois.
Lors des échanges, il est décidé que la Marmite rouge constituera et animera une formation d’une quinzaine d’heures autour de la SSA. En parallèle, la Marmite rouge contacte Bénédicte Bonzi, sociologue spécialisée dans la solidarité alimentaire, pour aider à animer les ateliers de conventionnement avec Cop1.
L’été et le mois de septembre sont productifs: les rencontres régulières entre Cop1 et la Marmite rouge permettent de construire un plan de formation ambitieux. Dimensionné pour une quarantaine d’étudiant·e·s, sur cinq séances de trois heures, il vise à présenter de façon approfondie ce qu’est la SSA, et les différentes formes qu’elle peut prendre. En accord avec les valeurs de la Marmite rouge, les animateurs et animatrices de l’association ont essayé de suivre une démarche d’éducation populaire. Les étudiant·e·s étaient mis·e·s au centre de la formation; les militant·e·s de la Marmite rouge n’étaient là que pour apporter des éléments de discussion. En facilitant l’expression d’expériences plurielles, les étudiant·e·s se sont construit leur propre idée d’une SSA, à leur image.
Les séances de formation se sont déroulées en autodéfense sanitaire, en partenariat avec des membres de l’Association de réduction des risques aéroportés (ARRA) et le Mask Bloc Paris. Des masques étaient disponibles gratuitement, et des purificateurs d’air installés. Former à la sécurité sociale passe aussi par prendre soin collectivement les un·e·s des autres, en rendant l’espace de formation plus inclusif.
• Déroulé et contenu de la formation
Chiffres-clés
- 5 séances de 3h chacune
- Plus de 40 étudiant·e·s formé·e·s
- Trois lieux: Césure, Espace Paris Jeunes, Cantine de Cop1
- 6 intervenant·e·s extérieures
Malgré des horaires tardifs (19h-22h en général), la plupart des séances comptaient entre trente et quarante participant·e·s. Elles avaient lieu en alternance à Césure, dans un Espace Paris Jeunes et à la Cantine de Cop1.
Séance 1 – Le système agro-industriel (16 octobre)

L’objectif de la séance introductive était ambitieux. Tout d’abord, il était question de fournir un cadre permettant à quarante inconnu·e·s d’échanger sur leur rapport à l’alimentation; les étudiant·e·s étant souvent placé·e·s en situation de précarité alimentaire par l’insuffisance du montant des bourses et des systèmes de soutien collectifs. Pour ce faire, les militant·e·s de la Marmite rouge prévoyaient des brise-glaces à chaque début de séance et beaucoup d’animation en petits groupes.
Après une introduction à la prise de parole en collectif et une prise de parole sur la Covid-19 et l’autodéfense sanitaire, la formation a débuté par une discussion autour de mèmes sur la vie étudiante et un débat mouvant. Le thème: «On paie suffisamment la nourriture.» Après des échanges riches et quelques changements d’opinion, tout le monde a savouré une pause bien méritée autour d’un buffet. Les militant·e·s de la Marmite rouge ont ensuite enchaîné sur l’animation de la première partie de la Fresque de la SSA, qui présente le système agro-industriel et ses limites.
Séance 2 – La Sécurité sociale de la santé (5 novembre)
Dans l’Espace Jeunes, les étudiant·e·s ont visionné le documentaire La Sociale. Muni·e·s d’un glossaire à compléter en cas de besoin, ils et elles ont découvert l’histoire de la Sécurité sociale. Après le buffet (qui deviendra traditionnel), les étudiant·e·s ont participé à un débat en petits groupes de quatre ou cinq personnes : ils et elles étaient invité·e·s à partager leur histoire personnelle avec «la Sécu». Beaucoup ont parlé de la CAF, notamment des APL, et ont comparé les systèmes de sécurité sociale d’autres pays avec le nôtre. Les étudiant·e·s ont ensuite eu à reconstruire l’organisation de la Sécu telle qu’ils et elles la perçoivent, et à imaginer à quoi pourrait ressembler la SSA si elle suivait le modèle de la Sécu. Ce matériel sera réutilisé en séance 5.
Séance 3 – Théâtre-forum avec Bénédicte Bonzi sur l’aide alimentaire
Cette séance a été coconstruite avec Bénédicte Bonzi. La sociologue a animé des saynètes pendant lesquelles les étudiant·e·s devaient incarner des personnes en demande d’aide alimentaire, ou des bénévoles à l’aide alimentaire lors d’une distribution de produits. Les étudiant·e·s pouvaient ainsi comprendre comment l’aide alimentaire peut être porteuse de violence – malgré le dévouement sans faille des militant·e·s de ces associations.
Séance 4 – Table ronde: «Quelle alimentation voulons-nous pour demain?»

Cette séance proposait d’échanger avec des intervenant·e·s issu·e·s du monde académique, paysan, associatif et institutionnel. Pour horizontaliser ce format, les intervenant·e·s et les étudiant·e·s étaient placé·e·s sur deux grandes tables (pour réduire la taille des groupes et favoriser la prise de parole). En milieu de séance les intervenant·e·s ont changé de table pour que les étudiant·e·s puissent discuter avec tout le monde.
Les intervenant·e·s étaient :
- Thomas Gibert, secrétaire national de la Confédération paysanne et maraîcher en Haute-Vienne, installé dans une ferme collective qui transforme une part de sa production en fromage, pain et bière notamment. Les deux principales revendications de la Confédération Paysanne sont l’obtention d’un prix minimum garanti, et la sortie des traités de libre-échange.
- Nora Bouazzouni, journaliste et écrivaine, écrivant principalement sur l’alimentation, le genre et les violences dans la restauration. Autrice de Mangez les riches – La lutte des classes passe par l’assiette (2023), Steaksisme – En finir avec le mythe de la végé et du viandard (2021) et Faiminisme – Quand le sexisme passe à table (2017), elle y pose des questions comme: «Depuis quand la nourriture a-t-elle un genre? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les kebabs? Qui a décidé que les hommes n’aimaient pas le rosé? Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme un régime dévirilisant?»
- Mathilde, professeure de droit à l’université du Connecticut et détachée auprès du CNRS. Ses recherches portent notamment sur la réglementation de l’alimentation et ses conséquences sur la société. Dans «The Whiteness of French Food: Law, Race, and Eating Culture in France» (2021), elle propose le concept de «blanchité alimentaire», qui illustre comment les Appellations d’origine protégée (AOP), les obligations de «neutralité» en cantines scolaires ou l’idée même de «repas français» perpétuent des mécanismes de domination raciale et coloniale.
- Véronique Bedu, ancienne militante au sein de la Conserverie solidaire à Saint-Denis et à Stains. L’association collecte des fruits et légumes abîmés, les transforme en confiture et les redistribue lors d’événements ciblés ou auprès de populations fragiles comme les étudiants de Paris 8 ou les mineur·e·s exilé·e·s. La Conserverie solidaire réfléchit à la mise en place d’une expérimentation de SSA plus formalisée.
- Elyne Etienne, spécialiste des politiques agricoles et alimentaires durables, et en particulier des enjeux liés à l’élevage, au bien-être animal, aux engrais et à l’accaparement des terres agricoles, sous l’aspect social, environnemental et sanitaire. Écoféministe engagée pour la transition agroécologique et des relations paisibles entre humains et non-humains, elle a été responsable du pôle Végécantines à l’association végétarienne de France (AVF) avant de rejoindre les Amis de la Terre et la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) où elle est désormais responsable Élevages durables.
Séance 5 – 2e partie de la Fresque, bilan et introduction sur le conventionnement

Lors de cette dernière séance-bilan, les étudiant·e·s ont suivi la seconde partie de la Fresque de la SSA développée par la Marmite rouge. Cette pratique a été mise en relation avec leur propre production de la séance 2. Ils et elles ont ensuite effectué un petit retour d’expérience et parlé des séances de conventionnement consécutives à la formation animée par la Marmite rouge.
• Apporter notre vision de la SSA et s’adapter à notre public
Les étudiant·e·s formé·e·s à la SSA sont désormais mieux équipé·e·s pour comprendre le système de Sécurité sociale, et orienter leur expérimentation de SSA dans une direction qui leur convient.
Cette formation a été très stimulante pour les militant·e·s de la Marmite rouge. En la concevant et en l’animant, nous avons produit un discours cohérent autour de la SSA, accessible et adapté à notre public.